La gestion périopératoire des patients traités par anticoagulants (antivitamine K, anticoagulants oraux directs) est complexe et porteuse de risque. Elle nécessite une bonne connaissance des référentiels (SFAR, GIHP, sociétés savantes) pour rédiger les procédures locales pour les interventions programmées et urgentes, pour les cas les plus simples et les plus complexes en collaboration étroite entre différentes spécialités chirurgicales et médicales. Elle nécessite également une répartition des taches (« qui fait quoi? ») entre les anesthésistes réanimateurs et les opérateurs (chirurgiens, médecins interventionnels) pour déterminer clairement qui s’occupe du préopératoire (délais d’arrêt ou maintien, relais ou non) et du postopératoire (relais, thromboprophylaxie, délais de reprise du traitement initial).
Établir une procédure locale pour le patient anticoagulé
La mise en place d’une procédure locale doit s’appuyer à la fois sur les référentiels des sociétés savantes et sur les caractéristiques propres à l’établissement. L’objectif est de décrire clairement le parcours du patient anticoagulé, de manière à garantir sécurité et cohérence entre les différents intervenants.
S’appuyer sur les recommandations existantes
La procédure doit se baser sur les recommandations officielles :
- HAS 2008 pour les AVK,
- SFAR/GIHP pour les AOD.
Elle doit préciser :
- l’attitude à adopter selon les indications les plus fréquentes des anticoagulants au long cours (valves mécaniques, fibrillation atriale, maladie thrombo-embolique veineuse)
- les délais d’arrêt et les situations nécessitant un relais héparinique,
- la nécessité éventuelle d’examens biologiques (INR, concentration d’AOD).
Identifier les gestes interventionnels fréquents
Il est essentiel de lister les interventions les plus courantes réalisées dans l’établissement et de déterminer :
- dans quels cas il est nécessaire de suspendre le traitement anticoagulant pour assurer une hémostase optimale,
- dans quels cas le traitement peut être maintenu sans risque.
Définir les responsabilités des intervenants
Chaque étape du parcours périopératoire doit préciser « qui fait quoi » : anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens, médecins interventionnels, etc. Cela permet d’éviter les ambiguïtés et de sécuriser la prise en charge.
Structurer le parcours du patient anticoagulé
Le parcours doit inclure :
- la création d’un passeport du patient anticoagulé, regroupant les décisions prises pour la gestion des anticoagulants,
- des aides-mémoire sur la gestion périopératoire pour faciliter la prise de décision,
- la traçabilité de la stratégie adoptée et du suivi tout au long du parcours dans le dossier médical,
- l’assistance d’un médecin spécialiste de la pathologie (cardiologue, médecin vasculaire, hémostasien, interniste) pour justifier la pertinence du traitement anticoagulant,
- l’assistance éventuelle d’un laboratoire de biologie compétent pour réaliser des dosages spécifiques d’AOD,
- la rédaction d’une lettre de transmission au médecin traitant détaillant la stratégie de reprise du traitement anticoagulant et les modalités de surveillance.
Préopératoire : recueillir et tracer les informations
La phase préopératoire consiste à recueillir toutes les informations concernant le geste interventionnel proposé et les modalités de traitement par anticoagulants. Cette étape est cruciale pour anticiper les risques hémorragiques et planifier une prise en charge sécurisée.
Identifier le risque hémorragique
Il est nécessaire de déterminer si l’intervention proposée comporte un risque hémorragique accru en présence d’anticoagulants.
- Une liste d’interventions à risque hémorragique, réalisées dans l’établissement figure dans la procédure locale et dans les référentiels.
- Cette liste permet de guider la décision concernant la suspension ou le maintien du traitement anticoagulant.
Recueillir les informations sur l’anticoagulant
Pour chaque patient, il faut déterminer précisément l’anticoagulant utilisé et son suivi :
- Type d’anticoagulant : AVK ou AOD (rivaroxaban, apixaban, dabigatran),
- Dose et nombre de prises,
- Date et heure de la dernière prise en cas d’urgence.
Dans la majorité des situations, les indications courantes sont :
- Valve cardiaque mécanique → AVK uniquement,
- Fibrillation atriale → le plus souvent AOD,
- Maladie thrombo-embolique veineuse → le plus souvent AOD.
Consultation du médecin référent si nécessaire
Pour les indications moins fréquentes ou complexes, il peut être nécessaire de consulter le médecin référent du patient (médecin traitant, cardiologue, médecin vasculaire, etc.).
Gestion périopératoire : collégiale, partagée et tracée
La gestion périopératoire du patient anticoagulé repose sur une approche collégiale impliquant l’opérateur, l’anesthésiste et l’équipe médicale. Elle doit être documentée et tracée dans le dossier du patient pour garantir la sécurité et la cohérence des décisions.
Élaborer une stratégie adaptée au double risque hémorragique et thrombotique
La stratégie doit être établie en fonction :
- du risque hémorragique lié à l’intervention,
- du risque thrombotique propre au patient.
Cette stratégie doit être :
- validée par l’opérateur,
- validée par l’anesthésiste, notamment en cas d’anesthésie loco-régionale,
- conforme aux modalités définies dans la procédure locale adoptée par l’équipe.
Selon la situation, plusieurs options sont possibles :
- Maintien du traitement anticoagulant, si le geste le permet,
- Arrêt simple sans relais, applicable à tous les AOD et le plus souvent aux AVK,
- Arrêt avec relais héparinique, jamais pour les AOD, mais parfois pour les AVK dans certaines situations à haut risque : valve cardiaque mécanique, FA avec antécédent d’AVC ou d’embolie systémique, antécédent récent (< 3 mois) d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde.
Tracer la stratégie décidée
La stratégie envisagée doit être consignée dans le dossier médical selon la procédure locale, ou de façon collégiale sans les situations plus complexes.
Associer le patient à la démarche
Le patient (et, si nécessaire, son accompagnant) doit être informé et impliqué dans la gestion périopératoire de son traitement, il est donc nécessaire de vérifier la bonne compréhension des modalités de gestion (dates d’arrêt, relais, reprise, etc.) et l’informer des complications potentielles.
Vérifications préopératoires finales
La veille ou le jour de l’intervention, il est indispensable de s’assurer que la stratégie préopératoire a bien été suivie, que les examens biologiques nécessaires ont bien été réalisés et leur résultat ont bien été consignés et vus.
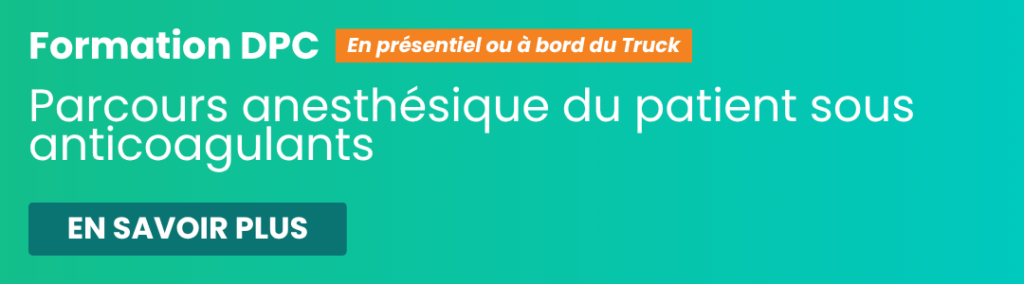
Au bloc opératoire : la check-list, un moment clé et obligatoire
La check-list opératoire constitue un outil essentiel — et obligatoire — pour sécuriser la prise en charge du patient anticoagulé. Elle permet de vérifier que toutes les étapes de la stratégie périopératoire ont bien été respectées et comprises par l’ensemble de l’équipe.
Accueil du patient (Sign In)
Lors de l’arrivée du patient au bloc, il est impératif de vérifier à nouveau l’arrêt ou le maintien du traitement anticoagulant, l’heure de la dernière injection d’héparine en cas de relais préopératoire des AVK, vérifier que l’INR du matin ou de la veille est bien inférieur à 1,5 ou 1,2 (selon le type d’intervention ou pour réaliser une anesthésie loco-régionale).
Avant l’incision (Time Out)
Avant le début du geste interventionnel, l’équipe doit confirmer la stratégie et échanger avec l’opérateur et/ou l’anesthésiste réanimateur.
Avant la sortie du patient (Sign Out)
Avant que le patient quitte le bloc opératoire ou le plateau interventionnel, plusieurs vérifications sont indispensables :
- Confirmer la stratégie de gestion postopératoire des anticoagulants, en tenant compte du déroulement de l’intervention et d’éventuels événements peropératoires (saignement, décollement, etc.),
- Déterminer le délai de reprise de l’anticoagulant au long cours ou du début de l’administration d’une héparine sous cutanée, en précisant la dose et le protocole,
- Clarifier les responsabilités postopératoires, « qui fait quoi » : suivi en hospitalisation, prescription à la sortie, relais avec le médecin traitant,
- Tracer les décisions et les informations partagées dans le dossier médical.
Postopératoire : reprendre le traitement anticoagulant à la bonne dose, au bon moment
La période postopératoire est la plus à risque pour le patient anticoagulé. C’est à ce moment que peuvent survenir la majorité des événements hémorragiques, souvent liés à des erreurs de timing, de coordination ou de prescription.
Éviter les pièges fréquents
Les erreurs évitables les plus souvent identifiées sont :
- une reprise trop précoce d’une anticoagulation curative,
- un relais trop rapide HBPM/AVK, période pendant laquelle le niveau d’anticoagulation est excessif (dose curative d’HBPM + INR > 1,5),
- l’association de médicaments interférant avec les anticoagulants ou augmentant le risque hémorragique,
- la survenue de complications qui augmente le risque de saignement (insuffisance rénale),
- une erreur de prescription ou d’administration (relais inapproprié, double prescription, erreur de dose, etc.), souvent liée à un manque de coordination entre intervenants,
- des problèmes de compréhension du patient.
Surveiller les risques thrombo-emboliques
Les événements thrombo-emboliques sont plus rares mais d’une gravité potentiellement majeure. Les facteurs de risque sont multiples: la pathologie justifiant le traitement anticoagulant, le geste invasif potentiellement inflammatoire et prothrombotique, l’arrêt de l’anticoagulant, l’administration de médicaments procoagulants (en cas de choc hémorragique par exemple) et le délai de réintroduction de l’anticoagulant.
Assurer un suivi clinique et biologique coordonné
Un suivi rigoureux est indispensable et doit être confié à un médecin référent clairement désigné dans la procédure (chirurgien, anesthésiste-réanimateur, ou autre) qui assure ce suivi :
- Quand débuter une thromboprophylaxie veineuse postopératoire ?
- Quand reprendre le traitement anticoagulant curatif, une fois le risque hémorragique maîtrisé ?
- Avec quel médicament : HBPM ou anticoagulant habituel du patient ?
- Les examens biologiques nécessaires (INR, créatininémie postopératoire) ont-ils été prescrits et vus ?
- Qui rédige la lettre de liaison avec le médecin traitant ?
- Qui prépare la prescription de sortie, en précisant clairement les modalités éventuelles de reprise du traitement ?
- Une conciliation médicamenteuse par un pharmacien dans l’établissement est-elle prévue pour vérifier la cohérence de l’ordonnance de sortie ?
Informer le médecin traitant et impliquer le patient
La reprise postopératoire de l’anticoagulant n’est pas toujours synchronisée avec la sortie du patient, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en ambulatoire. Il est donc important que la lettre de liaison et l’ordonnance de sortie précisent avec clarté :
- la date de reprise du traitement anticoagulant,
- la dose prescrite, si elle a été modifiée en cours d’hospitalisation,
- la date d’arrêt d’un relais héparinique sous cutané postopératoire après la reprise des AVK et l’obtention d’un INR en zone thérapeutique,
- la date d’arrêt d’un relais héparinique postopératoire et la reprise le lendemain d’un AOD, sans chevauchement entre les deux traitements.
En cas d’urgence : coopération, réactivité et médicaments dérivés du plasma…
La prise en charge pour une chirurgie urgente d’un patient anticoagulé répond à des stratégies relativement bien établies :
- Interroger le patient ou son entourage selon les mêmes modalités que pour la chirurgie programmée. Pour les AVK, obtenir le dernier INR disponible et pour les AOD, préciser la date et l’heure de la dernière prise.
- Disposer des médicaments permettant de reverser l’action anticoagulante des anticoagulants. Pour les AVK, utiliser la vitamine K et les concentrés de complexes prothrombiniques et pour les AOD, recourir aux concentrés de complexes prothrombiniques.
Conclusion :
Les événements indésirables associés à la gestion périopératoire des anticoagulants sont fréquents et potentiellement évitables par une bonne organisation par l’écriture de procédures couvrant les activités de l’établissement, la collégialité dans les prises de décisions et la traçabilité des décisions. Néanmoins, une bonne gestion périopératoire n’annule pas le risque de saignement ou d’événement thrombotique mais les réduit significativement.
| Étape | Action essentielle |
| Procédure | Basée sur des référentiels et élaborée de façon collégiale. |
| Préopératoire | Recueillir les informations concernant le patient et l’intervention, établir une stratégie coordonnée (arrêt, maintien, relais). |
| Bloc opératoire | Partager les informations et confirmer les décisions aux trois temps de la check-list. |
| Post-opératoire | Détecter les complications, reprendre le traitement anticoagulant à la bonne dose et au bon moment, informer le médecin traitant et impliquer le patient. |
Article rédigé par le Pr Pierre Albaladejo, Médecin Anesthésiste-Réanimateur au CHU Grenoble Alpes
Publié le 20.10.2025.